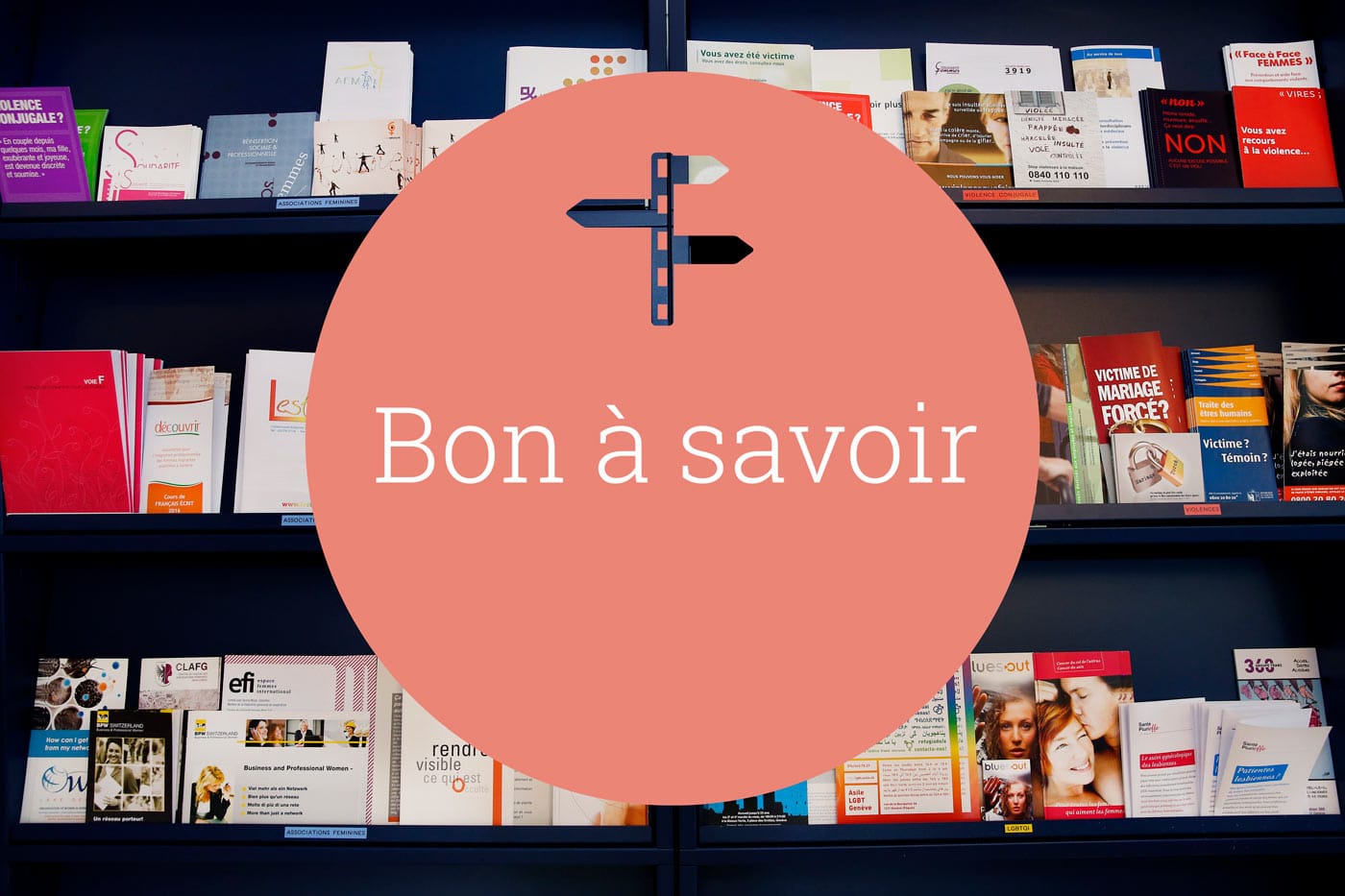Droit à la santé: spécificités pour les femmes*
Par Alessandra Fasciani, juriste à F-information
Accoucher, consulter, se faire opérer, accéder à un traitement: autant de situations dans lesquelles les femmes sont amenées à interagir avec le système de santé. Pourtant, ces expériences sont encore trop souvent marquées par une asymétrie d’information, un manque de transparence ou des décisions médicales prises sans leur plein consentement. Or, la législation suisse garantit des droits fondamentaux aux patientes, notamment le droit à l’information, au consentement libre et éclairé et à l’accès au dossier médical. Ce texte a pour objectif d’expliquer de manière claire et concrète les droits des femmes en matière de santé. De les outiller pour qu’elles puissent mieux comprendre leur position dans le système de soins, poser les bonnes questions, revendiquer leur autonomie et, le cas échéant, s’opposer à des pratiques qui porteraient atteinte à leur intégrité.
Droit à l’information
En tant que patiente, vous avez le droit d’avoir une information claire sur votre état de santé, les traitements possibles avec leurs bénéfices et leurs risques, les conséquences si vous ne prenez pas le traitement et la garantie de remboursement de la prise en charge par l’assurance de base obligatoire[2]. La jurisprudence précise également que vous avez le droit d’être informée sur vos chances de guérison[3].
Il est possible de demander un résumé écrit de ces informations et vous avez également le droit de connaître l’identité du chirurgien ou de la chirurgienne qui pratiquera l’opération[4].
Un exemple de manque d’information pourrait être la prescription de la pilule contraceptive pour des troubles hormonaux comme le syndrome des ovaires polykystiques ou de l’acné. En effet, la pilule contraceptive sous sa forme combinée (œstroprogestative) ou seulement progestative est efficace mais il reste essentiel d’être informée de ses effets secondaires, des différences entre les pilules et de leurs alternatives possibles.
Le consentement libre et éclairé
Un acte médical peut être considéré comme un acte illicite sous deux angles. Le premier est la violation des règles de l’art de la profession[5] et le deuxième est la violation du devoir du ou de la médecin de recueillir le consentement libre et éclairé de la patiente.
De quoi parle-t-on quand on dit «consentement libre et éclairé» dans le domaine médical? Cela signifie qu’avant toute intervention ou traitement médical, le ou la médecin doit obtenir un consentement de la patiente qui doit être donné librement, c’est-à-dire sans pression extérieure, et de manière éclairée. Cela implique que la patiente a reçu toutes les informations nécessaires afin de se forger sa propre opinion et de prendre sa décision en toute connaissance de cause[6]. La notion de consentement est protégée par la Constitution suisse quand ce dernier touche à notre intégrité physique; des sanctions pénales sont également prévues[7].
Il faut préciser que le consentement n’a pas besoin d’être formulé par écrit et peut être simplement oral ou tacite[8]. Par contre, c’est aux médecins de prouver qu’ils ont bien informés la patiente et obtenu son accord. C’est la raison pour laquelle, les professionnels ou professionnelles de la santé peuvent demander un consentement écrit et signé.
Par ailleurs, on a le droit de refuser ou d’interrompre un traitement et de quitter un établissement de soins à tout moment.
Certaines interventions liées à l’accouchement, comme la péridurale, la provocation de l’accouchement ou la césarienne, sont des pratiques médicales qui doivent être expliquées correctement et qu’il est possible de refuser notamment si la situation n’est pas urgente. Il est recommandé de planifier en amont un plan de naissance afin de pouvoir connaître les différentes options et de mettre ses souhaits par écrit. Aux HUG par exemple, des rendez-vous sont proposés pour établir ce plan de naissance[9]. L’Arcade Sages-Femmes propose également des séances collectives à ce propos[10].
Quelle attitude adopter face aux médecins?
Plusieurs études ont montré qu’il existe des inégalités de la prise en charge de la douleur et du diagnostic chez les femmes[11]. La difficulté liée au diagnostic vient notamment du fait que les recherches médicales ont souvent été faites sur des hommes, et, dans le cadre de certaines maladies telles que l’infarctus du myocarde[12], que les symptômes diffèrent significativement entre les sexes. Cela a pour conséquence un retard de diagnostic ou un mauvais diagnostic. Les femmes reportent également plus d’effets secondaires avec les médicaments[13]. S’agissant de la prise en charge des douleurs et des maladies chroniques, des hypothèses émergent d’un «dysmorphisme sexuel dans la biologie même de la douleur liée à la testostérone» [14].
Lors de la consultation avec son ou sa médecin, il est recommandé de préparer une liste de questions types à poser telles que les différentes options de traitement possible, les risques et les avantages de chaque option, les probabilités que ces risques se réalisent ou encore ce qui se passe si on ne suit pas le traitement. Dans certaines situations, on peut aussi demander aux médecins d’expliquer pourquoi ils pensent que tel symptôme n’est pas préoccupant ou s’ils ont déjà suivi des patientes ayant vécu une situation similaire. Il ne faut pas hésiter à faire répéter les explications si elles ne sont pas claires. Il est également possible de venir accompagnée d’un ou d’une proche lors d’une consultation. Par ailleurs, la demande d’un deuxième avis médical est souvent recommandée, de même qu’un résumé écrit ou une brochure informative afin de pouvoir réfléchir posément.
En conclusion, il est important d’être consciente du caractère sociétal de ces inégalités tout en gardant à l’esprit que le médecin doit être non pas notre ennemi, mais notre allié de santé. Établir et entretenir cette relation de confiance et de franchise est aussi indispensable au traitement.
Accès au dossier médical
La patiente a le droit de demander son dossier médical et de s’en faire expliquer la signification. Elle peut, sauf exceptions, obtenir son dossier gratuitement. Toutefois, les notes personnelles des médecins ne font pas partie du dossier accessible[15]. Si une information contenue dans le dossier médical est inexacte, la patiente peut demander une correction.
En conclusion, la garantie des droits des patientes est un pilier essentiel d’un système de santé qui fonctionne. Le droit à l’information, au consentement libre et éclairé, à l’accès au dossier médical ou encore à une prise en charge adéquate sont autant de fondements juridiques destinés à protéger l’intégrité, l’autonomie et la dignité des femmes dans le cadre de leur parcours de soins.
Toutefois, les écarts entre les normes légales et les pratiques concrètes demeurent. Il appartient aux institutions de santé et aux autorités de veiller à ce que ces droits soient pleinement garantis, y compris dans les contextes où les rapports de pouvoir ou l’urgence médicale peuvent fragiliser leur effectivité.
Promouvoir une culture du soin fondée sur l’écoute, le respect et la transparence, c’est aussi reconnaître les spécificités de l’expérience des femmes dans le système de santé. C’est encourager leur participation active aux décisions qui concernent leur corps, leur santé et leur avenir.
F-information offre des permanences juridiques gratuites par téléphone au 022 740 31 11 les mardis de 11h à 13h, mercredis de 14h à 16h et jeudis de 12h à 14h, hors vacances scolaires. Pour des questions spécifiques à votre santé, consultez également les permanences juridiques de l’APAS ou du Groupe santé Genève. A recommander aussi l’Espace Santé Femmes* du Réseau Femmes*, lieu d’échanges et de partages qui organise des actions de prévention et de promotion de santé.
Notes
[1] L’appellation femmes* désigne toute personne qui se reconnaît en tant que femme ou socialisée en tant que telle.
[2] Pour Genève, art. 45 al. 1 LS.
[3] ATF 133 III 121, consid. 4.1.2.
[4] Voir TF, 6B_902/2015, 13.5.2016 c. 4.2.2.
[5] Spécificité du contrat de mandat avec les médecins. Ils ont un devoir de diligence mais n’ont pas d’obligation de résultat donc si l’opération échoue, ce n’est pas pour autant qu’ils n’ont pas respecté les règles de l’art de leur profession et que l’on peut se retourner contre eux.
[6] A Genève, c’est l’article 46 LS pour le consentement.
[7] L’article 10 al. 2 de la Constitution fédérale et l’article 27 et 28 de Code civil garantit l’intégrité physique. Toute atteinte requiert le consentement. L’article 122 et suivant du Code pénal prévoient des sanctions en cas de lésions corporelles sans consentement.
[8] TF, 6B_910/2013, 20.1.2014, c. 3.2.1 et 3.4.4.
[9] https://www.hug.ch/obstetrique/suivi-votre-grossesse.
[10] https://arcade-sages-femmes.ch/series/plan-de-naissance/.
[11] https://www.health.harvard.edu/blog/women-and-pain-disparities-in-experience-and-treatment-2017100912562.
[12] https://swissheart.ch/fr/connaissance-et-support/dossiers/linfarctus-du-myocarde-est-diff%C3%A9rent-chez-la-femme.
[13] https://news.uchicago.edu/story/women-are-overmedicated-because-drug-dosage-trials-are-done-men-study-finds.
[14] https://www.illustre.ch/magazine/medecine-et-genre-il-faut-inverser-la-logique-de-certaines-recherches.
[15] Au niveau fédéral c’est l’art. 8 al. 1 LDEP. Pour Genève c’est l’article 55 LS.